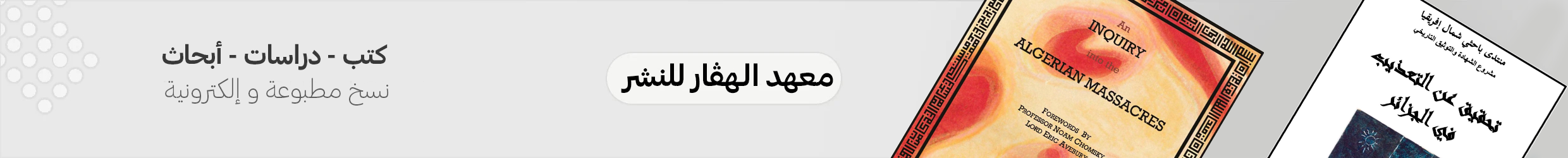La date du 6 février 1956 représente incontestablement le vrai tournant de la guerre d’Algérie. Ainsi, bien que la victoire de la gauche soulève l’espoir de voir se terminer « la guerre imbécile », pour reprendre les termes de Guy Mollet lors de la campagne pour les législatives du 2 janvier 1956, il n’en reste pas moins que le centre de gravité du pouvoir ne se trouve pas à Paris. En fait, avant même la formation du gouvernement, les milieux ultras commencent à s’agiter. « Ils s’indignent, en effet, de la présence, au sein de ce cabinet, du bradeur de l’Afrique noire, François Mitterrand, devenu garde des Sceaux, et plus encore de celle de leur vieil ennemi, Pierre-Mendès France, qui revient au pouvoir comme ministre d’État sans portefeuille », écrit Jean FINOIS, dans la revue « Historia ».
Mais, celui qui focalise toutes les attentions, c’est le général Georges Catroux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’entre ce dernier et les pieds-noirs, les rapports tumultueux remontent au moins à 1944 lorsque le général de Gaulle l’a désigné « Haut commissaire » pour les « départements d’Algérie ». Censé mettre en œuvre des réformes libérales, le général Catroux n’a convaincu aucune communauté. Cela dit, si les Algériens trouvaient les réformes insuffisantes, dont l’octroi de statut français à près de 60000 Algériens, les ultras prenaient ces réformes pour une déclaration de guerre.
Cependant, lors de l’investiture de Guy Mollet le 1er février, ce dernier déclare que le sort de l’Algérie ne peut plus être traité unilatéralement. Bien que le statut de 1947 ait été jugé insuffisant par les Algériens en son temps, Guy Mollet le remet derechef sur la table. Pour mettre en œuvre ces promesses, le président du Conseil décide de se rendre en Algérie. « Je me rendrai dès le 6 février à Alger et je déposerai une gerbe de fleurs au monument aux morts. Je procéderai ensuite à toutes les consultations utiles pour m’informer et mieux connaitre les aspirations de tous. Après quoi, j’installerai officiellement le général Catroux, qui arrivera le 10 février », annonce-t-il lors du conseil des ministres du 3 février 1956.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette annonce provoque l’effervescence dans les milieux ultras. « C’est, dès lors, à Alger, le branle-bas de combat. Pendant que le leader socialiste s’en va, le 4 février, dans sa circonscription d’Arras, fêter son investiture au milieu de ses amis, les grandes organisations traditionnelles de l’activisme algérois commencent à mobiliser leurs troupes pour relever comme il convient le défi qui vient d’être lancé à la population européenne », écrit Jean FINOIS. Pour forcer le président du Conseil à la palinodie, les organisations ultras, allant des anciens combattants aux étudiants, sont en alerte maximale. À la veille de la visite du responsable de l’exécutif, les organisations ultras adoptent une déclaration dans laquelle ils exhortent les pieds-noirs à un sursaut salvateur. « Il n’y a pour vous que deux issues : la réaction massive ou la mort », écrivent-ils.
Quoi qu’il en soit, malgré les conseils prodigués par certains ministres, dont François Mitterrand, pour qu’il n’y aille pas, le 6 février 1956, l’avion de Guy Mollet atterrit à Alger vers 14h30. Toutefois, si à la périphérie, la ville parait morte, il n’en est pas de même au centre où les pieds-noirs l’attendent de pied ferme. Selon Albert Paul Lentin, « un clameur qui ne cesse de s’enfler accueille le président du Conseil dont la Delahaye noire apparait, à 15h25, au bout de l’avenue Pasteur. Huées, coups de sifflet, insultes. Les manifestants du square Lafferrière arrachent les drapeaux tricolores qui décoraient la façade blanche du bâtiment de la grande poste. La foule crie : Mollet au poteau !, Mollet à la mer, l’armée avec nous, la police avec nous. »
Dans ce climat délétère, le président du conseil est contraint de faire marche arrière. Du monument aux morts, où il a déposé une gerbe de fleurs, au siège du gouvernement général, où il a admis sa défaite face au chantage des ultras, sa vie tient à un coup de fil : obtenir la démission du général Catroux. En plus, a-t-il un autre choix ? Il semblerait, d’après Albert Paul Lentin, que l’espace de manœuvre du président du Conseil soit très réduit. « Les hauts fonctionnaires en poste à Alger –notamment le préfet Collaveri et le secrétaire général du gouvernement général Maurice Cuttoli –lui disent que le calme ne reviendra pas dans la ville tant que ne sera pas prise la décision douloureuse, mais nécessaire de remplacer le général Catroux par un homme acceptable pour la population européenne », note-t-il.
Ainsi, bien que le président du Conseil soit réticent à l’idée de lâcher son protégé, il finit par appeler l’Élysée, où se trouve au même moment le général Catroux. Après un entretien avec René Coty, le président de la République, qui lui assure que le général Catroux est prêt à démissionner, Guy Mollet appelle ensuite Matignon. Au bout du fil, il donne une instruction claire à son chef de cabinet, Louis Faucon, à qui il demande « de joindre, au palais de la Légion d’honneur, celui qui n’est plus ministre résident et pour lui expliquer plus en détail les raisons du lâchage qui est imposé par la raison d’État.»
D’ailleurs, le calme n’est revenu qu’après 17H, heure à laquelle les ultras apprennent la démission du général Catroux. « Au tour du palais d’été, la foule se rassemble pour écouter la harangue d’un ancien combattant : c’est vrai, c’est bien vrai. Catroux a démissionné. Catroux, nous avons eu sa peau. Guy Mollet, nous lui avons fait toucher les épaules », résume-t-il la joie des ultras. Enfin, vers 19H, le président du Conseil tient une conférence de presse. Pour détendre l’atmosphère –à vrai dire, il admet tout bonnement sa défaite –, Guy Mollet revient sur ce qui s’est passé depuis son arrivée à Alger et conclut, compte tenu du climat qui règne à Alger, que sa promesse de collège unique n’est plus d’actualité. Selon Albert Paul Lentin, « les Européens ultras viennent de comprendre –et c’est là un tournant de la guerre d’Algérie –que s’ils mettent le paquet, ils peuvent peser sur le gouvernement de la République, infléchir sa politique, lui dicter leur loi. Les plus audacieux pensent qu’ils viennent d’avoir la preuve que le pouvoir débile de Paris pourrait être renversé à Alger. »
Ce projet sera mis en œuvre deux ans plus tard, le 13 mai 1958. Mais en portant à la tête de l’État un home de forte personnalité, les ultras pourront-ils garder le contrôle ? Le coup de force produit l’effet inverse. En fait, à mesure que le pouvoir du général de Gaulle se renforce, celui des ultras diminue proportionnellement. Du coup, malgré l’adhésion de certains militaires de carrière à leur plan diabolique, les ultras ne réussiront pas à faire vaciller le pouvoir gaullien. Et cela au grand bonheur des peuples, français et algérien, qui retrouvent la paix. Et sans la soif de pouvoir de certains dirigeants algériens –l’armée des frontières, commandée par Houari Boumediene, qui s’est emparée illégalement du pouvoir –, les Algériens seraient épanouis sur tous les plans. Hélas, l’Algérie indépendante ne profite qu’à un cercle restreint. C’est comme si l’Algérie était condamnée à vivre éternellement sous la domination.
Boubekeur Ait Benali
7 février 2015