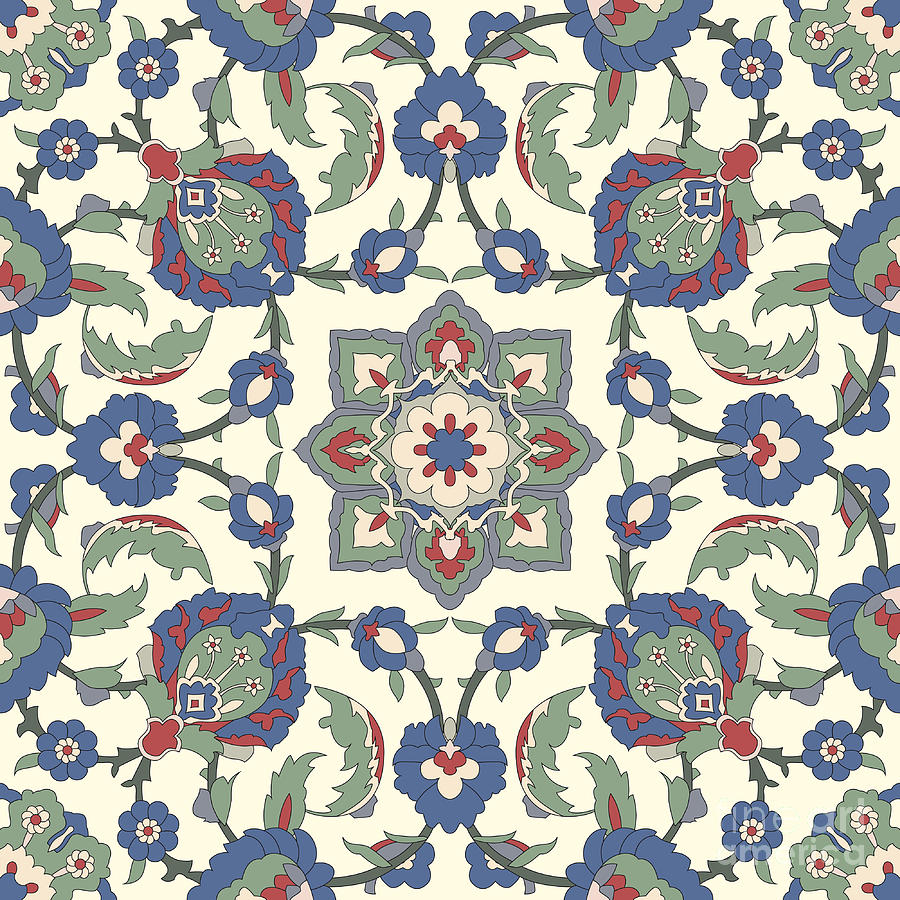Le 2 mars 1951, Bennabi commence à rédiger ses mémoires intitulés Pourritures, titre choisi pour décrire l’état de décomposition avancée de sa société. Son récit débute en décembre 1931, alors qu’il était étudiant à Paris, par une conférence faite auprès de l’association des étudiants musulmans nord-africains. La conférence, « Pourquoi nous sommes Arabes », dont le contenu ne nous est pas parvenu, suscite l’enthousiasme des étudiants maghrébins où il fut qualifié alors de «doctrinaire de l’unité nord-africaine» et proposé à la présidence de l’association. Bennabi nous révèle seulement qu’il avait placé sa conférence « sous la lumière de l’histoire générale de l’Afrique du Nord ».
Le 22 février 1966, il commence la rédaction du deuxième tome de ses Mémoires d’un témoin du siècle dont le premier tome, l’Enfant, a été livré l’année précédente. Il sera édité en arabe dès 1969 et il faudra attendre la fin 2006 pour que la version française soit publiée. Il couvre grosso modo la même période que le tome I de Pourritures, paru presque en même temps, et à la différence de ce dernier, il débute en septembre 1930. Les deux livres relatent, bien entendu, les mêmes évènements, à la différence notable que dans le second, Bennabi va taire la plupart de ses acerbes critiques sur les personnages animant la scène maghrébine, tout en accentuant le côté « mémoires » avec plus de souvenirs.
Mais étrangement, il va nous donner un autre titre à sa fameuse conférence qui devient, « Pourquoi nous sommes Musulmans ». Pourquoi ce changement ? Est-ce que dans l’esprit de Bennabi, les deux termes, Arabes et Musulmans, sont interchangeables ? Ou plutôt l’étaient-ils en 1951 et ne l’étaient plus en 1966 ?
Nous remarquons d’abord que c’est une affirmation et non une interrogation. Affirmation applaudie par d’autres étudiants maghrébins qui deviendront des personnalités éminentes dans leur pays respectifs comme les Marocains Mohamed el-Fassi (1908-1991) et Ahmed Balafrej (1908-1990) ou les Tunisiens Salah Ben Youcef (1907-1961) et Hédi Nouira (1911-1993) qui y voyaient la base de l’unité maghrébine.
Si le terme Musulman ne souffre d’aucune ambiguïté car défini dans un hadith du Prophète, c’est celui d’Arabe qui est perçu différemment.
Les Arabes se définissent exclusivement par leur langue, même si, aux temps anciens, tribalisme oblige, la lignée avait son importance. Ibn Khaldoun classifie, dans sa monumentale œuvre, le Livre des Exemples, les différentes strates des Arabes par leur proximité avec leur langue. Si nous prenons la traduction du baron de Slane (1801-1878), réalisée au milieu du XIXe siècle, notre penseur maghrébin en voit quatre : les Arabes arabisants, les Arabes arabisés, les Arabes successeurs des Arabes et les Arabes barbarisants. Cette dernière appellation concerne, par exemple, les tribus des Banou Hilal et des Banou Souleym qui s’établirent au Maghreb à partir du milieu du XIe siècle, venant du Nejd après avoir longtemps séjourné en Haute Egypte, et indique que leur langue arabe s’est corrompue et a perdu de sa pureté, de sa « fassaha ».
Le verbe dont le mot arabe est le substantif signifie s’exprimer avec une extrême concision, sans aucune ambiguïté possible. Ibn Khaldoun nous donne l’étymologie de ce verbe : quand une femme fuit le domicile conjugal la nuit de ses noces, elle indique clairement qu’elle refuse cette union. Bennabi nous a gratifié de belles phrases sur la consubstantialité des Arabes et de leur langue tout en écrivant qu’ils ciselaient leurs mots comme les Grecs le faisaient avec le marbre. Il a comparé les grands poètes arabes au plus célèbre des sculpteurs grecs, Phidias (490-430 av. J. C.), le maître du Parthénon. Nous connaissons aussi les fameuses joutes poétiques avant et après l’avènement de l’islam. Ibn Khaldoun nous a narré ses joutes poétiques avec son ami, le penseur et homme d’Etat andalou, Lissaneddine ibn al-Khatib (1313-1374).
Très peu de peuples se qualifient par leur langue. En Europe, par exemple, seuls les Basques le font. Pour eux le Basque est celui qui parle la langue basque (l’euskara) et leur pays est celui où on parle basque (Euskal Herria). L’origine de cette langue, non indo-européenne, est, d’après les linguistes, un isolat, c’est-à-dire, qu’il ne se rattache à aucun rameau connu. C’est la langue européenne la plus ancienne dans le continent. A la manière des Arabes, l’ethnocentrisme est inconnu chez eux.
Nous pouvons penser que si Dieu a choisi la langue arabe pour transcrire l’unique message originel où Sa Parole nous est transmise telle qu’Elle, c’est à cause du triptyque, langue concise, un peuple chevillé à sa langue et qui ignore l’ethnocentrisme. C’est ce triptyque qui a permis de souder en une communauté unique, la Oumma, de nombreux peuples de l’Indus à al-Andalus. Le mérite, dans la formation de l’Empire arabo-musulman, en revient aux Omeyyades. Les peuples qui intégraient la Oumma étaient aussitôt considérés comme lui appartenant d’une manière pleine et entière, même si l’élément arabe gardait la préséance uniquement pour des raisons d’ancienneté dans l’islam. Cette catégorisation, nécessaire pour les débuts afin de maintenir la cohésion de l’ensemble, était aussi dans le Coran où la différence se faisait entre les Arabes convertis d’avant Badr et ceux qui sont devenus musulmans après Badr. Le second calife, Omar, le véritable fondateur de l’Etat musulman, avait lui-même catégorisé les musulmans en Ahl al-Ayyam, ceux qui ont lancé leur monture les premiers contre la Perse et en Ahl al-Quadissiya, ceux qui allaient emporter une bataille décisive contre les Perses (636).
Les différentes populations de l’Afrique du Nord, les Afariks, mélange de Byzantins, d’ancien Carthaginois, de Numides urbanisés et de Vandales, qui parlaient le punique, le grec ou le latin, et les autres groupes numides et maures ont intégré massivement la Oumma, ont fait corps avec elle dans sa Marche vers le Nord (Drang nach Norden) pour porter le message coranique. Le triptyque évoqué plus haut a affermi leur volonté non seulement de s’islamiser mais aussi de s’arabiser tant qu’ils sentaient que devenir Arabes n’avait aucune connotation ethnique. C’était participer à une intégration d’un genre nouveau soudée par une conviction religieuse très forte et une communauté linguistique intimement liée à leur credo. Ce sont les Masmoudas devenus Almohades, une des nombreuses populations berbères, originaires de Tinmel dans le Haut Atlas à une centaine de kilomètres au sud de Marrakech qui vont édifier le Maghreb arabe au XIIe siècle. Et ce sont eux qui vont porter haut et fort l’arabisation à ceux qui n’avaient pas encore eu la possibilité de s’arabiser.
Les Omeyyades ont réussi à maintenir l’Unité profonde de la Oumma et c’est la manière dont les Abbassides sont parvenus au pouvoir qui amènera, à long terme, le venin de la « chu’ubiyya » (ethnicisme) en passant par l’abandon de larges territoires à l’Occident comme à l’Orient de l’Empire. L’assassinat de la presque totalité des Omeyyades a eu pour conséquence l’édification de l’émirat andalou en 756. Dès 800, le calife abbaside Haroun Rachid autorise la création de l’émirat Aghlabide à l’ouest et son fils al-Mamun celui des Tahirides à l’est et nous eûmes un peu plus tard dans l’extrême-est celui des Samanides.
Il est remarquable que la « chu’ubiyya » ne se soit développée qu’à l’est de l’Empire dans les anciens territoires sous domination perse. Certains orientalistes ont voulu la voir aussi en al-Andalus avec l’épître d’Ibn Gharsiyya (m. 1084), poète et secrétaire à la cour de Mudjahid à Dénia, un des « muluk al-tawaif » qui ont vu le jour après la dislocation du califat omeyyade. Or Afif Ben Abdesselem, auteur de la vie littéraire dans l’Espagne musulmane sous les Muluk al-Taw’if, Ve/XIe siècle montre que non seulement, il n’existe pas d’autres écrits andalous de la même teneur mais que les nombreuses et vigoureuses réponses en soulignent l’incongruité. En outre Ibn Gharsiyya était un nouveau converti qui n’avait pas saisi pleinement le sens de l’unité en islam.
L’explication la plus commune de la « shu’ubiyya » dans l’extrême Orient de l’Empire musulman est le souvenir vivace de l’ancienne splendeur perse. Celui-ci n’était, en fait, que l’apanage d’une faible élite et en réalité ce furent les différents pouvoirs turcs qui lui permirent de devenir une réalité et de subjuguer l’ensemble de la population. Les Turcs ne commencèrent à se convertir à l’islam qu’au Xe siècle et leur psychisme ne fut pas forgé par la première et vigoureuse intégration islamique des débuts. C’est aussi le fond de l’analyse de l’historien français Jean-Paul Roux (1925-2009), auteur d’une préface à la réédition en 1984 de la traduction du Traité de Gouvernement du fameux premier ministre des Grands Seldjoukides, Nizam al-Mulk (1018-1092). Le premier grand texte en persan, langue adaptée de l’ancien perse mais en caractères arabes, est le Shah Nameh (le livre des Rois) de Ferdowsi (ca 940-1020). Ce dernier fut le protégé de Mahmoud de Ghazna (971-1030), le plus fameux souverain de la dynastie des ghaznévides, la première dynastie musulmane turque. De nombreux intellectuels de la région se sont élevés contre ce début de « shu’ubiyya » protégé comme ce fut le cas de l’historien et philologue al-Thaalibi (961-1038), né et mort à Nishapur dans le nord-est de l’actuel Iran. Toute son œuvre fut en langue arabe et il fut aussi l’auteur d’une histoire des Rois de Perse ce qui montre qu’il ne négligeait pas l’histoire anté-islamique quand elle était marquante. A la différence de Ferdowsi, natif de Tus ville située dans la même région que Nishapur, qui a fait de son livre un tremplin de l’ethnicisme persan, al-Thaalibi fit de son œuvre un combat contre ce même ethnicisme. Cependant la physionomie persane de la région est uniquement redevable de l’action des différentes dynasties turques, la seldjoukide, celle des Ilkhans (turco-mongols) et la safavide.
Nous comprenons maintenant pourquoi Bennabi s’est basé sur l’histoire générale de l’Afrique du Nord pour juger de son unité. Elle est restée exempte de « chu’ubiyya » car elle est le produit de la grande intégration arabo-islamique, celle des origines. Cette intégration a tellement marqué l’esprit populaire que pour les Maghrébins, Musulman et Arabe, sont devenus synonymes.
A la différence de la « chu’ubiyya » moderne influencée par les nationalismes issus des convulsions européennes du XIXe siècle, celle que nous venons d’évoquer plus haut a voulu se situer dans son environnement islamique. Elle s’est basée sur le verset coranique : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle ; et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux, fidèle, dévoué. » (IL, 13)
Par rapport au sujet que nous traitons dans ces lignes, ce verset comporte deux volets, un constat ou un existant et un but à atteindre. Le premier est l’existence de peuples et de tribus et le second nous avertit que l’important c’est de s’entre-connaître afin de parvenir à obtenir le meilleur des mérites auprès de Dieu. Le mot-clé est le terme arabe « taqwa ». Il est traduit généralement par piété et ici on lui a adjoint fidélité et dévouement. Or étymologiquement, il a surtout le sens de prévention et de préservation. L’islam est venu comme un puissant facteur d’unification du genre humain. Dans sa première grande action d’intégration, il a fondé la Oumma, et une des plus nobles démarches est de prévenir les facteurs de division et de préserver son bien social le plus important, son Unité.
La lutte idéologique dans ses menées contre l’islam a souvent pris la langue arabe comme cible. Affaiblir la langue arabe devenait un moyen pour atteindre l’islam. Que de doctes discours, ignorant superbement l’histoire, ont affirmé sous le magister dixit que la langue arabe ne pouvait être qu’une langue liturgique. Le problème n’est pas dans l’existence de la lutte idéologique mais dans les « cerveaux » qu’elle réussit à embrigader. Ceux de l’élite pour devenir ses courroies de transmission et ceux de la masse pour établir des « évidences » paralysantes. La seule démarche que n’utiliseront jamais la lutte idéologique et ses servants internes et externes est l’étude comparée qu’elle soit historique ou linguistique car le stratagème serait vite éventé.
Voyons, par exemple, le problème qui a été posé par la graphie des langues des peuples musulmans. Le remplacement des caractères arabes de la langue turque en caractères latins fut directement influencé par son précédent bosniaque quand il fut instauré de force par l’Empire austro-hongrois à partir de 1878, date de l’annexion de la Bosnie-Herzégovine, alors province ottomane. Il est bon de rappeler que cette annexion fut accompagnée d’une féroce répression où de nombreuses mosquées furent détruites. Si l’imposition des caractères cyrilliques en remplacement des caractères arabes des langues des peuples musulmans sous domination russe s’est faite de force, que penser du remplacement par les caractères latins de la langue malaise -qui est la même en Indonésie et en Malaisie- ou du somali orchestré par les élites modernistes autochtones ?
Un autre exemple instructif est l’étrange attitude d’une partie de l’émigration arabe cultivée qui a été prise d’un regain de religiosité où nous voyons hommes barbus et femmes portant le voile s’adressant à leurs enfants dans les langues de leur nouveau pays et négligeant de leur apprendre la langue du Coran. Et nous pouvons constater que d’autres nationalités, en particulier les Asiatiques, non seulement font maîtriser à leurs enfants leur langue d’origine mais aussi celle de leur pays de résidence. Il ne s’agit plus de capacités mentales ou matérielles mais d’un fort complexe d’infériorité insufflé par une lutte idéologique sans relâche.
Ce complexe est loin d’être l’apanage de la masse mais toujours surtout de l’élite avec des conséquences d’autant plus graves en relation avec l’influence qu’elle a sur les gens. Prenons un exemple concernant directement notre sujet. Nous avons vu que la relation qu’entretiennent les Arabes avec leur langue était surtout à l’époque du Prophète fusionnelle. Un des arguments qui a emporté leur adhésion à l’islam est l’inimitabilité du style coranique et c’est ce qu’on appelé l’i’djaz. Ce dernier pour être valable devait être le résultat de la comparaison du style coranique avec la poésie antéislamique. Mettre en doute son historicité, c’est vouloir saper l’authenticité du Coran. Plusieurs orientalistes s’y sont essayés mais le plus venimeux fut sans conteste David Samuel Margoliouth (1858-1940), orientaliste britannique connu pour sa franche hostilité à l’islam, qui publia sa thèse en 1925. D’autres orientalistes de renom ont démontré l’inanité d’une pareille thèse. Mais en 1926, elle fut reprise par Taha Hussein (1889-1973) qui lui donna une grande publicité au sein du monde intellectuel arabe avec son livre Fi chi’r al-Djahiliya.
L’irruption du nationalisme arabe dans la sphère politique arabe au début des années cinquante a sûrement amené Bennabi, dans le but d’éviter une méprise sur son acception du terme Arabes, à remplacer ce dernier par Musulmans. D’une communauté linguistique, le nationalisme, dont l’idée est venue d’Europe, va plutôt exalter l’aspect ethnique en proposant un autre mode d’intégration. Intellectuellement, le nationalisme arabe a vu le jour à la fin du XIXe siècle et un de ses théoriciens fut Abderrahman al-Kawakibi (1855-1902) qui par myopie politique s’en prit à l’Empire ottoman en ignorant les menées du colonialisme britannique. Il proposa par exemple que le titre de calife soit enlevé au sultan d’Istanbul pour être remis au Khédive d’Egypte qui n’était qu’une marionnette aux mains de la perfide Albion. Ses attaques sur le despotisme de la Sublime Porte montrent qu’il ignorait les vrais problèmes de la civilisation islamique. Le résultat de l’attaque contre l’Empire ottoman fut la Révolte arabe de 1916 et sa véritable conséquence la création par le colonialisme britannique de l’Etat d’Israël. L’apogée du nationalisme arabe fut la fondation du parti Baath (Résurrection). Un de ses théoriciens les plus renommés fut Michel Aflak (1910-1989), chrétien grec orthodoxe qui se convertit à l’islam vers la fin de sa vie. Il a laissé sur l’islam de très fortes paroles : « L’islam est la meilleure expression du désir d’éternité et d’universalité de la nation arabe. Il est arabe dans sa réalité et universel dans ses idéaux ». Cependant pour lui et tous les nationalistes arabes, l’islam est le produit du génie arabe alors que pour Bennabi, c’est exactement l’inverse. Et c’est cette immense différence que Bennabi a voulu souligner.
Abderrahman Benamara
Biskra, le 16 février 2018