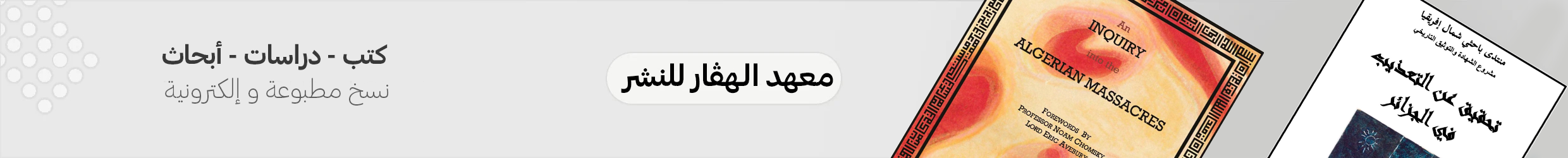« … je suis particulièrement tenté par une biographie, la plus tourmentée et la plus émouvante que je connaisse en Algérie ». C’est ainsi que débute la préface du Dr Abdelaziz Khaldi du livre les conditions de la Renaissance de Malek Bennabi en évoquant son auteur.
Comment ne pas avoir à l’esprit cette phrase quand on évoque la figure de Hamouda Bensaï?
En effet, le premier compagnon de Bennabi a eu une vie plus pathétique, douloureusement plus longue puisqu’à son décès il était presque centenaire.
Pourtant, le jeune Hamouda promettait !
L’historien de l’Islam contemporain Sadek Sellam nous le décrit comme un « parfait bilingue » collaborant aux journaux algériens de la fin des années vingt : « La voix indigène » en langue française et « En-Nadjah » en langue arabe. Il souligne « le prestige qu’avait eu dans les années 30 cet intellectuel auprès de toute une génération ». Le véritable coup d’envoi de sa renommée fut une retentissante conférence prononcée en 1932 en français auprès de l’Association des Etudiants Musulmans Nord Africain à Paris et en arabe au Nadi Taraqui à Alger. Son titre, « Le Coran et la Politique », valait à lui seul toute une philosophie, tout un programme. Le journal « La Presse libre » devait en faire un compte rendu enthousiaste dans sa livraison du 28 août 1932.
Peu de temps auparavant, vers la fin du mois de décembre 1931, Malek Bennabi faisait lui aussi une remarquable conférence, « Pourquoi sommes-nous musulmans? » (ou « Pourquoi sommes-nous Arabes? », Bennabi utilisait ces deux titres pour sa conférence) au local de l’AEMNAF à Paris.
Ces deux conférences intronisèrent les deux amis comme « des doctrinaires » du groupe d’étudiants maghrébins à Paris et Hamouda Bensaï fut élu vice-président de l’AEMNAF.
Rétrospectivement, Bennabi date de ces événements-là, dans son livre « Pourritures » écrit en 1951, le début de leurs ennuis.
Bennabi va connaître dans sa chair les enjeux de la lutte idéologique qu’il allait magistralement théoriser dans son livre « La lutte idéologique ».
L’essayiste et historien français Lucien de Bonald a écrit: « Depuis les Evangiles jusqu’au Contrat social, ce sont les livres qui ont fait les révolutions. »
Bennabi lui répondra en écho que ce sont les idées qui ont toujours mené le monde, les conflits économiques les accompagnent mais ne les transcendent jamais.
Tout comme il existe des institutions chargées de contrôler, par exemple, le flux de marchandises, d’autres ont pour mission le contrôle des idées.
Certains ont pignon sur rue et ont un rôle noble comme l’Université, d’autres ont, par contre, un fonctionnement occulte aux yeux de la plupart des hommes.
Le Docteur Abdelaziz Khaldi l’appelle le psychological service et Bennabi l’Observatoire idéologique.
Les personnes chargées de ces institutions savent que souvent il est inutile d’éliminer physiquement ceux qui portent des idées dangereuses pour l’ordre qu’elles défendent. Inutile, voire contreproductif, car l’assassinat crée le martyr qui par essence ne meurt jamais. Inutile surtout lorsqu’il est possible de discréditer ou d’acculer à la folie les « porteurs d’idées ».
Subissant les mêmes assauts Bennabi constatait que les embûches dressées tournaient surtout pour son ami au complexe de persécution. « Hélas, Mohamed Hamouda Bensaï était déjà sur cette pente savonnée qui mène à l’abîme ».
A l’inverse d’un Bennabi ou d’un Nietzsche, ces monuments de la pensée humaine, dont les immenses douleurs vécues, ont permis d’enfanter une oeuvre originale et dense, celles de Hamouda Bensaï l’ont presque totalement stérilisé.
Ame sensible, personnalité fragile ou pour reprendre l’expression du diplomate Noureddine Khendoudi dans son évocation, « moins battant, peu déterminé à résister, [Bensaï] a fini par céder ». Cependant une phrase de Bennabi, nous ouvre la voie à une autre raison, « … les idées qui ne pouvaient mûrir ni surtout être récoltées chez lui ont émigré chez moi ».
C’est le meilleur hommage qui pouvait être rendu à Mohamed Hamouda Bensaï. Mais il nous renseigne aussi sur les possibilités créées par la civilisation dans une société donnée. Une société civilisée ne fera pas de tous ses membres, un Ibn Khaldoun, un Ibn Sina ou un al-Asha’ari mais elle permettra à tous ceux qui ont de pareilles potentialités de les réaliser.
Issu d’une société qui n’avait plus rien à proposer à ses membres, Mohamed Hamouda Bensaï dut faire face à la plus féroce des adversités. Et une fois cette adversité atténuée, pourrait-il espérer qu’on lui reconnaisse au moins la qualité de combattant sur le front idéologique?
Mais c’était sans compter avec l’existence, comme nous le dit Noureddine Khendoudi d’ « une bien déplaisante habitude algérienne », l’indifférence totale, l’oubli du bon nombre de nos intellectuels qui ont combattu pour que l’âme algérienne ne sombre jamais malgré les terribles coups de boutoir de l’ennemi.
Un auteur ne disait-il pas que les nations vivent du souvenir de leurs héros?
Au lieu d’édifier un Panthéon avec inscrit au fronton: Aux grands hommes la patrie reconnaissante, nous ensevelissons nos intellectuels sous une lourde chape d’oubli.
Mohamed Hamouda Bensaï a rejoint ceux dont la mémoire algérienne ignore les noms mais qui sont une fierté pour l’esprit algérien et qui peuvent constituer une armature pour la pensée algérienne future.
Il a rejoint Aly El Hammami, ce héros de la guerre du Rif aux côtés de l’Emir Abdelkrim El Khatabi, cet homme qui a préféré l’exil à la vie sous l’occupation. Nous attendons toujours la concrétisation du projet proposé par le Docteur Saïd Benkehlil, député UDMA de Batna, au lendemain de sa mort en 1950 de réunir l’ensemble de ses écrits.
Il a rejoint Mohamed Tazrout, le témoin des débuts de la République chinoise en 1914, de la révolution bolchevique en 1917 qui parlait d’égal à égal avec le grand philosophe de l’histoire allemand Oswald Spengler dont il a traduit son livre-phare, le Déclin de l’Occident. Mohamed Tazrout est l’auteur de la volumineuse étude en cinq volumes sur l’histoire intellectuelle de l’humanité intitulé le Congrès des Civilisés ainsi que d’autres ouvrages.
Il a rejoint aussi d’autres intellectuels qui ont épousé avec conviction l’âme algérienne dans son entièreté, non par quelque idéalisme révolutionnaire ou humaniste.
Nous pensons au maurassien Mohamed Chérif (Pierre) Juglaret qui dirigea avec Ali Benahmed, cousin de Bennabi, mort mystérieusement en 1942, le journal « La voix du Peuple » de 1933 à 1935 puis le journal « la Défense » du chahid Lamine Lamoudi. Il devait lui aussi mourir en chahid pendant la guerre de libération nationale.
Nous pensons à Isabelle Eberhardt, disparue dans sa prime jeunesse, à 27ans, laissant une grande œuvre inachevée et qui souffre jusqu’à nos jours de l’ostracisme d’esprits étriqués.
Nous pensons au peintre et écrivain Nasreddine (Etienne) Dinet dont la notoriété n’a pas empêché que son mausolée soit violé et laissé à l’abandon comme le constatait il y’a presque 40 ans Bennabi.
Ceux qui connaissent la valeur des grands hommes et le sens des symboles ont refusé que le grand peintre échappe au pays qui l’a vu naître malgré que la conversion solennelle à l’islam de Dinet eut lieu peu avant le Centenaire. Le gouverneur général, Bordes,-après avoir détourné le cortège funèbre afin d’éviter l’hommage des Algérois- prononça son éloge funèbre où il souligne : « De même qu’il restait Dinet en devenant Nasreddine, le grand ami de l’Islam demeurait un fils de la France. »
Que dire aussi de l’ambassade de France à Alger qui baptisa son parc du nom d’Etienne Dinet?
Voilà des leçons pour ceux qui sont oublieux des grands hommes!
Abderrahman Benamara
4 juillet 2008