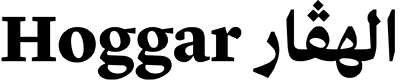Le palmarès putschiste de l'ANP est respectable même dans le championnat de pronunciamientos de la division Amérique latine, comme l'indique la table suivante de José Nun pour les coups d'Etat militaires réussis durant la période 1920-1960 :
|
Pays |
Nombre de coups |
Pays |
Nombre de coups |
|
Argentine |
7 |
El Salvador |
6 |
|
Bolivie |
9 |
Guatemala |
6 |
|
Brésil |
5 |
Haïti |
5 |
|
Chili |
2 |
Honduras |
2 |
|
Colombie |
2 |
Nicaragua |
1 |
|
Costa Rica |
1 |
Paraguay |
7 |
|
Cuba |
4 |
Pérou |
4 |
|
Rép. Dominic. |
4 |
Venezuela |
4 |
|
Equateur |
9 |
De 1920 à 1960, il y a eu donc au moins 78 coups d'Etat réussis, et tous les pays d'Amérique latine ont été touchés, excepté le Mexique et l'Uruguay qui ont quand même essuyé des tentatives de coup d'Etat durant cette période, deux dans le cas de l'Uruguay et au moins quatre pour le Mexique.
Un bon nombre des pays listés dans cette table ont subi d'autres coups d'Etat militaires durant les années 70 et 80, après quoi la fièvre putschiste s'est assagie sur ce continent. Mais en Afrique elle a continué sans relâche : l'Algérie en 1992, 1997 et 1998, la Sierra Leone, le Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Angola, le Niger, la Côte-d'Ivoire, les Comores etc. La récente résolution d'Alger de l'OUA, club des putschistes par excellence, interdisant les coups d'Etat ne dupe personne sur la perpétuation de ce fléau en Algérie et sur notre continent.
3. Qu'est-ce qui cause les coups d'Etat militaires ?
« Les militaires ya sahbi ! », me direz-vous. C'est une bonne réponse, bessah elle est tautologique.
Cette question est posée pour comprendre ce qui fait que dans nos bleds l'alternance des régimes se fait fréquemment par les coups d'Etat militaires, alors que dans les démocraties elle se fait par l'exercice de la souveraineté du peuple sans intervention militaire.
Bien sûr, cette question présuppose que les putschs sont intelligibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des phénomènes aléatoires, contingents, imprévisibles, indépendants et singuliers mais, au contraire, qu'ils partagent des propriétés communes accessibles à l'investigation.
Pour comprendre ces épidémies de putschs militaires, il est essentiel de distinguer nettement entre un prétexte , une raison et une cause .
Un prétexte c'est ce qui est allégué pour dissimuler le véritable motif d'une action. C'est, par exemple, ce que déverse la bouche de Nezzar, les apparences que colporte Ghozali, les couverts de Saïd Saadi, les alibis du dinosaure Hachemi Cherif, les justifications de Benchicou : Sauver « la démocratie », la « modernité », l'« Algérie », la « République » etc. Dans les centaines de coups et de tentatives de coups enregistrés ce siècle, et dont une bonne partie ont eu lieu suite à des élections présidentielles ou législatives, les prétextes invoqués par les putschistes et leurs apologistes partagent systématiquement deux dimensions communes : l'agitation d'un épouvantail (rouge, noir, vert, l'anarchie etc.) et le messianisme (sauvegarde de X, Y ou Z). Le prétexte relève de l'idéologie, de la mythologie, de la criminologie dans bien des cas, et non de l'explication.
Une raison traite de ce qui devrait arriver comme résultat de l'action qu'elle explique. Les véritables raisons, buts, motifs, intentions et choix des putschistes sont tournés vers le futur, contrairement aux causes qui se situent avant les putschs et doivent se réaliser, de fait, pour engendrer leurs effets. La raison relève de l'explication intentionnelle .
Une cause est ce par quoi l'effet se produit. Dire qu'un putsch P a une cause veut dire que sa réalisation est la manifestation d'une loi générale qui connecte l'ensemble des putschs {P} à un ensemble de conditions {C} qui les antécédent. (Voir note 1) Si la loi est déterministe il s'agit de cause déterministe, alors que si elle est probabiliste on parle de cause probabiliste, c'est-à-dire de cause qui rend les putschs plus probables. Parler en terme de cause relève de l'explication scientifique, « scientifique » dans le sens nomologique , pas dans le sens bien compris de la nébuleuse pagsiste.
Si c'est encore un peu flou, patience, ça va tout de suite s'éclaircir.
On ne traitera pas de l'explication intentionnelle même si c'est vrai que, dans un sens phénoménologique, chaque putsch, chaque tentative de coup, chaque conspiration de coup résulte des motifs d'un petit groupe d'officiers complotant secrètement. Mais si ces intentions sont importantes, il n'en reste pas moins que les actions des putschistes sont restreintes par des contextes structurels qui rendent leurs interventions plus ou moins probables. C'est précisément sur ces facteurs structurels, objectifs et mesurables, que les études scientifiques des coups d'Etat ont porté ces dernières décennies. (Parler de causes structurelles ne disculpe, bien sûr, en rien les putschistes des responsabilités de leurs actes.)
Les facteurs qui ont fait l'objet de plusieurs études sont :
· Le retard d'intégration ;
· La dépendance économique chronique sur l'extérieur ;
· Les tensions ethniques ;
· La centralité politique de l'armée ;
· La contagion putschiste ;
· Le clanisme au sein des armées ;
· La dépendance militaire externe.
On va passer ces facteurs en revue, à tour de rôle, de façon extrêmement brève. On va la faire de manière qualitative seulement, pour éviter de barber, surtout ceux qui ont la phobie des barbes et des barbus, avec les mesures, corrélations et probabilités statistiques et les problèmes de méthodologie et de données.