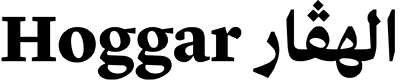C’est d’une curieuse manière que Bennabi a préfacé ses mémoires en les attribuant à un inconnu qui les lui aurait confiées lors d’étranges circonstances.
A première vue nous pourrions croire qu’il ne s’agit que d’un artifice littéraire pour que l’auteur introduise son autobiographie mais nous pensons qu’il n’en est rien.
Bennabi a réellement voulu prendre ses distances avec un ouvrage qui livre plus le climat psychologique d’une société dans une des phases les plus douloureuses de son histoire, sinon la plus tragique, que la vie d’un Algérien dans la tourmente de la décadence de sa civilisation.
Même si le prénom usuel de Bennabi est Seddik, c’est avec son prénom d’état civil Malek qu’il s’est forgé un nom au panthéon des hommes célèbres. En attribuant le manuscrit à Seddik, Bennabi a voulu le concevoir comme son double mais pas identique à lui-même.
C’est par cette rhétorique littéraire que Bennabi nous avertit que les véritables mémoires d’un témoin du siècle qu’il fut sont à attendre…
C’est ainsi que nous avons publié Pourritures.
Ce dernier livre, écrit dans des conditions très difficiles, n’en occulte pas moins tout l’intérêt de ce premier tome des mémoires de Bennabi qui non seulement nous brosse un saisissant tableau des transformations sociales et psychologiques des Algériens mais nous offre de méditer sur notre condition actuelle.
La société colonisée qu’il nous décrit est-elle réellement derrière nous ?
Si la colonisation fut une période sombre, l’indépendance qui y mit fin et permit l’espoir de la reprise en main du destin du pays n’est plus qu’un lointain souvenir dans une société assaillie par le doute sur son avenir.
Comparaison n’est pas raison nous dit l’adage mais elle permet de situer les états psychologiques qui mènent à la dérive.
Un chef d’Etat algérien n’ambitionnait pour son pays qu’à lui trouver une modeste place dans le nouvel ordre mondial voulu alors par le puissant du moment.
Comment éviter la comparaison avec cette fine réflexion de Bennabi où « les jeunes d’avant la Première Guerre mondiale n’avaient plus que le souci de s’installer le mieux possible dans l’ordre colonial » ?
Le premier tome des mémoires de Bennabi est une mine de tableaux d’états mentaux qui ont pour certains consolidé la colonisation en Algérie et pour d’autres permis sa libération.
Ces constatations lui sautaient tellement aux yeux qu’il nous confie que « c’était curieux, chaque Algérien de ma génération et capable de se servir d’une plume pouvait l’écrire. »
Les traits les plus saillants du livre se rapportent à sa ville natale Constantine –l’antique ville carthaginoise Cirta dont le nom dérive de la capitale Carthage et qui a la même signification de ville qu’on retrouve dans le mot arabe Qarya- qu’il croque dans un regard très attendri et mélancolique face à la disparition de ses traditions de vieille urbanité. Sa prime enfance fut bercée par les douloureux souvenirs de la prise de sa ville en octobre 1837 par les troupes d’agression françaises. Après un premier échec cuisant en novembre 1836, l’armée française après avoir stabilisé le front de l’Ouest par le traité de la Tafna le 30 mai 1837, mit toutes ses forces contre la capitale du beylik de l’Est défendue vaillamment par son dernier bey, el Hadj Ahmed Bey, son lieutenant Ali ben Aïssa et toute la population constantinoise. Son arrière grand-mère maternelle, jeune adolescente alors, dut fuir, à travers le chaos d’une ville que son armée et sa population défendait rue par rue, avec ses parents par la falaise qui domine le Rhumel pour éviter le suprême déshonneur. Les familles ayant des jeunes filles préféraient cette voie périlleuse et souvent mortelle que de les laisser tomber entre les mains de la soldatesque ennemie.
La famille maternelle de Bennabi refusant de cohabiter avec l’occupant a préféré quitter Constantine vers les années 1850 pour s’établir à Tébessa où la population européenne fut toujours négligeable et ne comprenait que le personnel nécessaire à la mainmise sur la ville.
D’une manière générale et à quelques exceptions prés la colonisation de peuplement fut négligeable dans l’ancien beylicat de Constantine à l’inverse de ce qui se passa dans le Centre et l’Ouest du pays.
L’Administration coloniale détruisit une partie de la ville de Constantine pour édifier la ville européenne qui vit aussi arriver à partir du début du siècle les premiers éléments francisés de la communauté juive autochtone. Ce désastre urbanistique va toucher toutes les villes historiques algériennes comme Alger ou Tlemcen.
La résistance des élites de ces villes se manifesta par l’exode de 1908 et surtout de 1912 pour refuser la circonscription militaire obligatoire, préparation par la France au sacrifice de dizaine de milliers d’Algériens sur les champs de bataille de la Première guerre mondiale.
Le grand-père, le grand-oncle et l’oncle de Bennabi émigrent vers la Libye en 1908. Son père ne les a pas suivis après le refus de son épouse de quitter sa mère malade. L’agression par l’Italie du dernier beylicat ottoman en terre africaine en 1911 les ramène manu militari à Constantine après avoir participé à la résistance libyenne.
A travers son histoire familiale, Bennabi note la lente agonie des catégories aisées qui en voulant sauvegarder leur statut entraînaient un appauvrissement plus rapide. Ce déclassement social s’accompagnait de la perte de tout l’environnement traditionnel, de ses traditions et de son artisanat qui était si vivant. Ce saccage par la colonisation de cet environnement est d’autant plus visible qu’il fut sauvegardé dans les deux autres pays maghrébins et surtout au Maroc où la colonisation fut infiniment moins féroce. Non par bonté d’âme bien sûr mais les circonstances de son installation furent différentes et elle ne put « produire toute la dégradation morale et sociale qu’elle portait en elle ».
Cette dégradation s’accentue à la fin de la Première guerre mondiale sous l’effet conjugué du passage d’une bourgeoisie héréditaire à une bourgeoisie de négoce et par l’accaparement des propriétés algériennes entre les mains de la communauté juive et des Européens alliés pour la circonstance.
A la différence des grandes mutations subies par des pays lors d’évènements économiques ou politiques importants –comme la fine description par l’écrivain di Lampedusa dans son livre le Guépard de la mutation qu’a connue par exemple la Sicile au milieu du XIXème siècle- qui fut endogène, celle de l’Algérie fut exogène et pilotée par l’occupant.
Mais malgré sa déchéance, « la vieille génération (…) a conservé le capital historique essentiel, ces traditions et cette âme sans lesquelles le pays ne pouvait plus refaire son histoire. »
Or que constatons-nous actuellement ?
Que notre capital historique essentiel est à la merci d’intellectomanes qui puisent leur inspiration dans l’historiographie coloniale et que notre âme est assaillie par la guerre sans merci livrée à la langue arabe par des officines officielles et officieuses et que ceux qui affichent leur islamité sans la langue arabe qu’ils résident dans l’axe Tanger-Djakarta ou en Occident ne se doutent pas qu’ils ouvrent des brèches béantes dans cet islamité.
Ils sont les descendants de ceux que le directeur de la médersa de Constantine Dournon favorisait.
« Dournon était indulgent à ceux d’entre eux qui avaient la réputation de faire leur prière et qui portaient gandoura et turban. Au fond de sa pensée, nous le savions déjà, il préférait leur apathie à la turbulence des « jeunes turcs ».
Bennabi nous donne de précieuses informations sur la genèse de l’idée nationale avec Abbas ben Hamana de Sétif qui sera assassiné à la veille de la Première Guerre mondiale et M’hamed ben Rahal de Nedroma. L’idée nationale est consubstantielle avec l’arabisation ou plutôt le retour naturel de la langue arabe dans l’enseignement voulue par tout le peuple algérien sans aucune exception. Abbas Ben Hamana fut à l’origine de la fondation de la première école arabe ou médersa.
Bennabi a connu la terre française pour la première fois pendant l’été 1925. Ses réflexions sur la perception du maghrébin en général et de l’algérien en particulier par la mentalité française est d’une brûlante actualité. Après leurs sacrifices pendant la guerre, ils furent honorés tous du titre de Sidi mais très vite ce dernier fut utilisé par dérision et devint un titre péjoratif. Ceux qui tempêtent aujourd’hui contre les musulmans au nom de cette plaisanterie appelée « terrorisme » et d’une manière plus hypocrite contre l’immigration au nom d’une autre plaisanterie appelée modèle social sont les descendants de ceux qui fulminaient contre l’invasion des Sidis et appelaient à cor et à cri leur interdiction de quitter l’Algérie pour se préserver de la plaisanterie alors qui avait pour nom « fanatisme ».
Rien de nouveau sous le ciel de la Méditerranée sauf qu’à l’époque les immigrants mourraient cachés dans les cales et qu’aujourd’hui ils se noient dans de frêles embarcations.
Ou plutôt si : à l’époque les braillards étaient plein d’arrogance et que maintenant, ils sont inquiets pour leur identité. C’est la déchéance des conquérants du monde qui se recroquevillent sur leur pauvre identité incapable de se défendre comme l’avaient fait auparavant tous les indigènes du monde devant la force de ceux qui les dominaient.
Seuls les naïfs ont la sensation que les raisons invoquées actuellement sont les véritables raisons de la stigmatisation des musulmans et ils s’échinent à prouver le contraire.
Quant aux autres, les modernistes et autres faussaires idéologiques, leur trahison est patente.
« Les intellectomanes que le colonialisme a lâchés dans le Souk idéologique algérien et qui monopolisent grâce à lui les moyens d’expression ont faussé les idées les plus élémentaires. »
Rajoutons à algérien, français et nous avons le champ complet de la lutte idéologique actuelle.
« Les attributs qui qualifient une société c’est la conscience collective et l’autonomie de ses décisions. »
Les avons-nous aujourd’hui ?
Abderrahman Benamara
5 juillet 2017