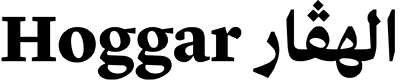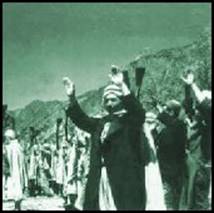Le 8 mai 1945 signifie la fin du nazisme. Il correspond aussi à l’un des moments les plus sanglants de l’histoire nationale. L’Algérie allait connaître un des événements les plus sanglants de son histoire. Suite à un soulèvement des Algériens contre l’occupation coloniale française, une répression hallucinante devait s’abattre sur les populations de Sétif, Guelma, Kharata, dans l’Est du pays. 45’000 morts à Sétif, Guelma et Kharata, tel est le bilan macabre de ces tragiques évènements.
Sur tous les continents, l’Humanité célébrait dans la joie son premier jour de paix et de liberté, après l’écrasement du nazisme. Mais l’idéologie raciste et dominatrice de ce dernier demeurait présente dans le régime colonial français. Il en donna alors une illustration qui lui vaudra un rang peu captivant dans les histoires des crimes contre l’Humanité. D’abord par l’ampleur des carnages et des hécatombes (en milliers, voire dizaines de milliers de personnes selon les évaluations) commis contre la population algérienne de la région de Sétif. Mais aussi par la barbarie des méthodes et leur signification politique, en contradiction certaine avec le vent de liberté qui soufflait sur l’échelle mondiale.
La mort d’un scout tué par la police française mettra le feu aux poudres à Sétif. Ce sera l’émeute. Un soulèvement spontané, appuyé par des militants nationalistes laissera place aux frustrations trop longtemps enfouies. On s’en prendra aux colons européens, à Sétif, Kharata, dans les campagnes environnantes et même à Guelma, pourtant éloignée de plus d’une centaine de kilomètres.
Pour toute réponse, la barbarie coloniale continue. L’après-guerre allait donc sonner le glas de la révolte et du changement. Les Français ont voulu frapper fort, du fait même qu’ils appréhendaient déjà cette révolte. Appréhension compréhensible quand on connaissait les recrues limitées dont pouvait disposer à ce moment la puissance coloniale pour un pays aussi grand et aussi rebelle. Il fallait massacrer le plus pour assurer la survie du système.
Ainsi, après mai 1945, le général Duval qui dirigea les semaines de répression impitoyable, en rendit compte à son gouvernement en énonçant l’avertissement suivant, qui était aussi sans qu’il le sache une vraie prophétie : « Je vous ai assuré la paix pour dix ans ».
(Photo: Arrestations de civils menés vers leur propre exécution avant de finir brûlés dans des fours à chaux de Guelma)
Ces massacres appelés la « Toussaint rouge », vont marquer le début de ce qui allait, 9 ans plus tard, devenir la guerre de libération déclenchée le 1er novembre 1954, que les colonialistes s’étaient chargés eux-mêmes de déclarer neuf ans auparavant, comme l’ont souligné nombre d’historiens non algériens. Déjà deux ans après mai 1945, un congrès clandestin du Parti du Peuple Algérien (PPA) avait décidé la création de l’Organisation Spéciale (OS) paramilitaire.
En fait, les machinations colonialistes avaient convaincu l’ensemble de la population, jusque dans ses couches les plus réformistes ou les plus timorées, que l’alternative du soulèvement armé devenait de plus en plus inévitable. L’Algérie, corps central du Maghreb, ne pouvait rester insensible aux agitations et aux flammes insurrectionnelles qui dans la première moitié des années cinquante embrasaient déjà ses flancs tunisien et marocain.
En 1945, d’un côté avaient grandi dans le monde colonial des aspirations nationales et sociales actives qui n’avaient pas encore acquis l’expérience et la maturité politique suffisantes. D’un autre côté, l’entêtement et l’arrogance raciste des puissances dominantes barricadaient sauvagement les issues démocratiques et les évolutions constructives souhaitables.
Que de tourments auraient pu être évités en deux décennies avant que De Gaulle parvienne à une vision qui concilie réalisme et intérêts nationaux avec les droits des peuples ? Quel prix économique et humain a-t-il fallu et va-t-il falloir encore payer des deux côtés de la méditerranée pour avoir trop longtemps considéré que les peuples arabes, berbères et tant d’autres maghrébins et orientaux, étaient héréditairement imperméables aux ambitions démocratiques et sociales modernes ?
Laakri-Louise Cherifi
23 mai 2014