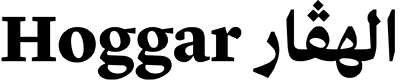Esquintée et indignée par le flot de promesses inconsidérées et insensées que l’on a déversées sur elle durant des décennies, la jeunesse algérienne assiste en direct lors de ces derniers procès de justice en cascade au spectacle des aveux publics de hauts cadres d’Etat impliqués dans de graves affaires de corruption. Du jamais vu dans l’histoire récente du pays! Du scandale de Khalifa à l’imbroglio de l’autoroute Est-Ouest, en passant par le feuilleton de Sonatrach I et II, l’opinion publique algérienne se retrouve seule, dans l’étonnement, prise jusqu’au cou par la nausée de l’amertume. Un malaise profond! Qu’en faire? Comment y procéder alors que l’on sait que plus rien ne marche correctement dans cette Algérie de contrastes? Sans doute, ce n’est ici que la face immergée de l’iceberg. Car, beaucoup d’affaires traînent dans les coulisses en attente d’être, le temps venu, révélées au grand public sur fond de règlements de comptes entre les clans de la haute hiérarchie. Force est de constater en conséquence que la grande corruption est non seulement un phénomène banalisé dans les pratiques mais aussi dans les discours, le vécu quotidien et les mœurs collectives de nos têtes dirigeantes. Un phénomène qui tend même à devenir par contagion une forme de revalorisation sociale parmi les couches déshéritées. Cela détruit le sens de l’éthique, de l’effort, du travail, la ponctualité, le civisme, le dévouement à la mère-nation, la solidarité, l’amour, etc. Bref, la mort lente de toutes les valeurs qui font de l’individu un citoyen conscient, lucide et progressiste. En plus, l’uppercut de ce choc est tel que tout le monde se soit vite rendu compte de la nullité des réformes promises par le premier magistrat du pays en avril 2011 suite aux troubles provoqués par le Printemps Arabe. Et que, par ricochet, nos institutions sont en complète déliquescence, exposées qu’elles sont à un dépècement permanent de toutes parts. Même leur noyau dur est, semble-t-il atteint.
Les questions qui se posent après tout ce déballage médiatique sont les suivantes : Comment peut-on encourager dans de telles conditions l’investissement économique étranger, le tourisme et la stratégie de la réindustrialisation mise en veilleuse depuis la fin des années 1970 en cette phase cruciale de «politique d’austérité» dont le Premier ministre Abdelmalek Sellal s’est fait le chantre? Et ensuite, comment serait-il possible d’inciter les opérateurs économiques nationaux et étrangers à faire confiance à nos mécanismes de contrôle, de régulation administrative et surtout à notre justice, son indépendance ; sa transparence? Et le comble, comment rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés et préparer le terrain à une passation de pouvoir entre l’ancienne et la nouvelle génération? Sûrement, il y a du pain sur la planche d’autant que, d’une part, le politique est trop décrédibilisé pour être cru ou suivi d’en-bas! D’autre part, les élites gagnées par le désintéressement nourrissent un mépris si froid à la chose publique. Elles se permettent tous les abus sur le dos de cette population livrée à elle-même. La douceur du vol dans l’anonymat, derrière des prête-nom, des hommes de paille et parfois via des sous-fifres sur lesquels on s’essuie le couteau dès que le forfait accompli se transforme, de nos jours, en un inextricable réseau de complicités dépassant les frontières. L’impact sur le train-train social de l’Algérie de demain sera énorme. Désormais, les quelques élites courageuses qui en restent vont devoir se confronter à de réelles difficultés quant à la persuasion du petit citoyen de leur bonne foi. Cette partie du poker menteur a désenchanté les esprits et justifié les limites des pratiques bureaucratiques, des malversations et des détournements de fonds publics à large échelle. Pour cause, point de démarche honnête ; constructive ; positive, rayonnant sur tout le territoire afin d’éradiquer ce fléau qui rampait depuis longtemps comme une chenille processionnaire. Ce qui en dit long sur l’impossibilité d’un acte crédible de démocratie participative.
A ce rythme, il ne sera plus plausible d’aller loin dans les réformes ni même s’assurer qu’il y en ait déjà eu. Le silence de Bouteflika d’un côté et le cri de Louisa Hanoune de l’autre en rajoutent de l’angoisse. Pratiquement, rien qui vaille la peine d’être raconté de «cette éternelle retardataire» sur tous les fronts qu’est l’Algérie. Quand un cadre ou un haut responsable double d’ingéniosité pour rendre la vie de ses compatriotes insupportable, ceux-ci finissent sans doute par céder par lassitude mais concoctent mille scenarii dans leurs têtes pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Autrement dit, on peut avoir pour longtemps sa victime à sa merci mais personne ne nous garantit de sa docilité définitive. Ces têtes qui ne reculent devant rien pour corrompre ne savent pas à quel point ils enfoncent le clou dans les plaies de notre jeunesse et l’incitent à la révolte. La peur intériorisée risque de se libérer un jour de façon très violente. Car, les inégalités moins évidentes à reconnaître, plus insidieuses et plus difficiles à dénoncer de par le passé se recopient sur le net à la minute près de nos jours.
Le danger est bien réel dans la mesure où cette question de la corruption n’est en aucune manière une histoire d’amour entre le peuple et ses dirigeants, mais une histoire de pouvoir imposée par les supérieurs à leurs subordonnés! Une histoire qui se mélange à toutes les sauces. Et puis, entre les radicalement pauvres et les injustement riches dont a accouché cette malédiction du pétrole, l’idée-maîtresse qui en sort souvent est qu’il y a consommation de rente sans contrepartie, c’est-à-dire, sans productivité ni prix de revient. Le capital national étant dilapidé et l’endettement symbolique de l’Algérie d’aujourd’hui en valeurs morales dépasse de loin ce que l’on est en mesure ou en droit de croire. Il faut rallumer les énergies nationales, cultiver l’intelligence, civiliser les mœurs, éduquer les esprits, les rendre plus souples aux défis de l’ouverture, de la tolérance, de la modernité, etc. Le salut ne vient pas de la culture de l’assistanat ni de la corruption, encore moins de notre dépendance des efforts des autres nations «travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds qui manque le moins» écrit Jean de La Fontaine (1621-1695) dans ses fables il y a de cela quelques siècles. A bon entendeur.
Kamal Guerroua
17 mai 2015