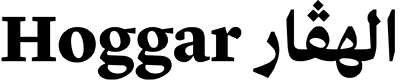Depuis la formation des États-Unis d’Amérique, leur politique varie selon leurs desiderata. De la politique de non intervention dans les Affaires des autres pays, les États-Unis, après la seconde guerre mondiale notamment, deviennent le gendarme du monde. Comment s’est faite cette mutation ? Dans la première période, la politique américaine consiste à se débarrasser de la tutelle britannique encombrante à leur essor. Pour ce faire, ils s’interdisent toute immixtion dans les Affaires des autres pays. Ainsi, en vertu de ce principe, ils ne tolèrent pas que quiconque intervienne dans les leurs. Fondée en 1823 par le président Monroe, cette politique de non-ingérence isole, par la même occasion, les États-Unis du reste du monde.
Quoi qu’il en soit, après la guerre de sécession, où les problèmes entre le Nord et le Sud sont résolus, les États-Unis construisent petit à petit un empire économique solide. Très vite, la surproduction devient un frein sérieux à leur épanouissement. Dans un discours au sénat américain, le 27 avril 1898, le sénateur Albert-Jeremiah Beverdige suggère une nouvelle orientation, sans pour autant toucher au principe sacro-saint de la non-ingérence. « Le commerce mondial doit-être et sera nôtre. Et nous l’acquerrons comme notre mère l’Angleterre nous l’a montré. Nous établirons des comptoirs commerciaux à la surface du monde comme centres de distribution des produits américains. De nos comptoirs de commerce, sortiront de grandes colonies déployant notre drapeau sur les ailes du commerce. Et la loi américaine, l’ordre américain seront plantés sur des rivages jusqu’ici en proie à la violence et à l’obscurantisme », déclare-t-il.
Cependant, à la différence des autres puissances coloniales, les États-Unis n’envahissent pas les territoires pour y rester, comme l’ont fait, avant eux, les Anglais ou les Français. Ainsi, bien que la politique isolationniste soit de vigueur, les États-Unis n’hésitent pas à s’emparer des territoires, tels qu’Hawaï, Cuba, Porto Rico, Philippines en 1898, Panama en 1904, Nicaragua en 1912, la République dominicaine en 1915, etc. Employant les mêmes procédés que les Anglais ou les Français, les militaires américains ne vont pas de mains molles. Justifiant cette violence, le général Shefter, le pacificateur des Philippines, déclare : « il sera peut-être nécessaires de tuer la moitié de la population pour que l’autre moitié de la population puisse être hissée à un mode de vie supérieur à l’actuel mode semi-barbare. »
En tout état de cause, avec de tels procédés, les États-Unis parviennent en peu de temps à contrôler la région en expulsant au passage les forces espagnoles en déclin. Incontestablement, au début du XXème siècle, les États-Unis sont une puissance régionale incontournable. Bien que l’occasion ne se soit pas présentée jusque-là, ils peuvent désormais jouer un rôle international de premier plan. Et cette occasion va leur être offerte après la première guerre mondiale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur entrée en guerre, en 1917, aux côtés des alliés, renforce davantage leur emprise et leur prestige. Face à une Europe affaiblie, le président américain contraint le vieux continent à adopter son plan. Sur les quatorze points de Wilson, du nom du président américain, les cinq premiers abordent le volet économique, en insistant sur le libre-échange.
Par ailleurs, bien que le congrès américain n’entérine pas le projet d’intégrer la SDN (société des nations), l’ancêtre de l’ONU (organisation des nations unis), l’influence américaine va crescendo. D’ailleurs, comment ça peut être autrement ? S’exprimant sur la situation européenne, le 29 décembre 1922, le secrétaire d’État, Charles Hughes, abat les cartes des USA. « Il est futile de dire que nous ne sommes pas intéressés par ces problèmes, car nous y avons un profond intérêt du point de vue économique, parce que nos crédits et nos marchés sont en jeu », argue-t-il. Cela dit, en se préoccupant par le seul souci de faire des profits, l’entre deux guerre plonge les États-Unis dans une crise de surproduction de 1929. Du coup, la seconde guerre mondiale les prend tout bonnement de court.
Encore une fois, étant donné que le conflit se déroule en Europe, les États-Unis en tirent les plus grands avantages. Désormais, ils sont les seuls maîtres du monde. En effet, avec 50% de production mondiale à la fin de la seconde guerre mondiale, les États-Unis imposent leur vision au reste du monde. Bien que l’union soviétique résiste cahin-caha à ce monopole –il faut dire que le système n’est pas du tout à envier –, les États-Unis, à travers l’octroi des crédits aux pays de l’Europe de l’Ouest (le plan Marshall), sont les vrais maitres du monde. Cette emprise se manifeste notamment par l’établissement des bases militaires dans les pays auxquels ils doivent de l’argent. Pour mesurer la grandeur de leur puissance, les États-Unis possèdent 820 bases militaires, dans 39 pays différents, au début du XXIème siècle, alors qu’ils n’avaient que quatre au début du XXème siècle.
Pour conclure, il va de soi que l’impérialisme américain ne diffère pas foncièrement du système colonial. Dans les deux cas, les victimes restent les peuples conquis. Bien que les présidents américains aient critiqué le système colonial, leurs méthodes ne sont guère meilleures. Au nom du combat contre le communisme, ils ont fait plusieurs guerres, notamment au Vietnam. Enfin, pour satisfaire leurs besoins énergétiques, ils ont enchainé des guerres au moyen Orient. Jusqu’à nos jours, un pays producteur du pétrole qui refuse de céder à leur chantage est exposé aux mesures de représailles. Et tout ça se fait au nom des droits de l’Homme et de la démocratie.
Boubekeur Ait Benali
4 novembre 2013